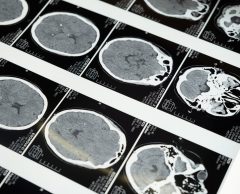Partager la publication "Rutger Bregman : “L’humain est bon, c’est scientifique”"
L’hommage est signé de l’Israëlien Yuval Noah Harari, auteur du best-seller Sapiens : « L’ouvrage de Rutger Bregman m’a fait voir l’humanité sous un nouveau jour. » Bel éloge pour cet historien néerlandais de 32 ans, qui a lui aussi – déjà – un essai best-seller à son actif. Dans Utopies réalistes (Seuil, 2017), publié dans 23 pays il revient sur la façon dont plusieurs grandes conquêtes politiques du siècle dernier – la fin de l’esclavage, le suffrage universel, le droit de vote des femmes – ont longtemps été considérées comme des utopies irréalisables, défendues par d’incurables optimistes.
Cette interview a initialement été publiée dans le numéro 32 de la revue WE DEMAIN, disponible sur notre boutique en ligne
Il y affirme que trois utopies concrètes deviendront demain évidentes.
1 : éradiquer la pauvreté par un revenu universel.
2 : profiter de la robotisation pour en finir avec le chômage et les travaux inutiles, avec une semaine de travail de 15 heures qui permettra aux humains d’inventer de nouvelles activités.
3 : réduire la pauvreté mondiale en laissant les gens aller et venir, gagner de l’argent et retourner chez eux, grâce à l’ouverture de toutes les frontières.
Pour les étayer, Bregman l’utopiste « réaliste » appuie ses propositions sur un nombre considérable d’études et d’expertises. C’est sa manière. Dans son dernier essai, paru en septembre, Humanité – Une histoire optimiste (Seuil), Bregman défend une idée simple, à rebours du discours ambiant : les humains sont bons, ils cherchent depuis toujours à s’entendre et à vivre en paix. Aujourd’hui, ils pourraient enfin y parvenir s’ils se persuadaient qu’ils ne sont pas aussi mauvais que beaucoup d’historiens et de philosophes le prétendent.
Pour nous convaincre, Bregman revisite plusieurs grands moments de l’histoire mondiale, montrant que depuis toujours les peuples et les personnes cherchent à s’entendre et à coopérer, mais qu’ils sont trop souvent trahis par leurs élites. Il remonte au temps pacifiés des chasseurs-cueilleurs, s’intéresse aux soldats qui refusent de se battre, raconte des mouvements de solidarité nés pendant des catastrophes, ou encore défend la théorie du « bon sauvage » de Jean-Jacques Rousseau.
Bien sûr, on trouvera parfois qu’il fait preuve d’un optimisme forcé ou même de naïveté. Ce à quoi il répond : « La méfiance envers le peuple a toujours servi à légitimer l’inégalité et la tyrannie. »
WE DEMAIN : À lire votre ouvrage, on se demande : vous êtes le dernier des optimistes, ou le premier d’une nouvelle génération ?
Rutger Bregman : Je m’inscris dans un mouvement à la fois scientifique et générationnel qui depuis une décennie remet en cause une vision sombre et défaitiste de l’humanité toujours très influente. Selon cette vision, qui a été revitalisée dans les années 1950 à la suite des crimes nazis, survenus dans un pays hautement civilisé, les humains seraient naturellement égoïstes, agressifs, violents, racistes, enclins à se combattre et s’entretuer dès qu’ils traversent une crise grave ou affrontent une catastrophe. Leur vernis civilisé s’effondre et ils révèlent leur vraie nature, qui est mauvaise…
J’en suis venu à penser le contraire à la suite de nombreuses recherches faites ces vingt dernières années en anthropologie, en archéologie, en sociologie, en psychologie sur l’empathie, l’entraide, les réactions de solidarité dans les situations de drame et de guerre. J’en ai dégagé cette idée-force : les humains ne cherchent pas à s’entredéchirer au premier drame. Au contraire : en général ils s’entraident, ils se montrent altruistes, ils fraternisent.
C’est un comportement qu’on retrouve dans la plupart des moments tragiques de l’histoire, j’en donne plusieurs exemples dans mon livre, comme les attitudes secourables des Anglais pendant les bombardements du Blitz en 1940-1941, ou la solidarité apparue au cours de l’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans en aout 2005. Au-delà des exceptions qui confirment cette règle, on voit ces mêmes attitudes de coopération, de convivialité, de patience et de respect dans nos vies quotidiennes, à un niveau familial, amical, professionnel… Elles sont en fait si prégnantes, si enracinées en nous, si intimement liées à la nature humaine que nous n’y prêtons plus attention.
Je retrouve aujourd’hui cette attitude coopérative et généreuse dans la nouvelle génération. Ils sont progressistes, activistes, utopistes, solidaires, ils défendent des idéaux pour lesquels ils sont prêts à se battre, ensemble, partout. Voyez l’énorme mobilisation des lycéens lors des grèves mondiales pour le climat ou encore l’essor de Black Lives Matter aux États-Unis. Ce sont des mouvements contagieux, qui redonnent confiance dans l’humanité. Je pense que l’espoir, l’utopie concrète et le militantisme sont le nouveau réalisme de notre temps, et mon livre s’inscrit dans cette vague de fond…
Vous proposez rien de moins qu’une histoire optimiste de l’humanité… Vous pensez vraiment que les premiers hommes étaient déjà bons ?
Il est évidemment difficile de savoir avec exactitude comment les populations humaines vivaient au temps des chasseurs-cueilleurs, mais nous pouvons nous appuyer sur nombre d’études anthropologiques sur les peuples qui ont continué de vivre, jusque très récemment, comme nos ancêtres. Il y a cette méta-analyse de 339 études de terrain faites en 2012 par Christopher Boehm, un anthropologue américain, les études réalisées en Amérique Latine par Douglas Fry regroupées dans The Human Potential for Peace (Oxford University Press, 2005), ou encre celles de plusieurs collectifs d’anthropologues publiées dans Plos One et dans Nature en 2012 et 2014…
Elles nous rapportent que les humains originels détestaient les inégalités, que les décisions sociétales et politiques se prenaient collectivement, et qu’ils se méfiaient de l’autorité – les chefferies s’imposaient par leur savoir-faire et leur charisme non par la violence. Les premiers hommes, des nomades, développent des mœurs conviviales, respectent les femmes en leur offrant une place sociale importante, travaillent peu et profitent de l’existence, la nature leur offrant ce dont ils ont besoin.
Bien sûr, il leur arrive de s’affronter entre différentes tribus, mais généralement, les recherches concordent sur ce point, les batailles font très peu de morts, s’arrêtent rapidement, demeurent symboliques. Rappelons que tous les grands explorateurs européens font état de la générosité et la douceur des peuples premiers qu’ils découvraient…
Dans son journal et ses lettres, Christophe Colomb raconte combien les habitants des iles où il a accosté se montraient accueillants. Il écrit avec étonnement : «Quoiqu’on leur demande de leurs biens, jamais ils ne disent non. Bien plutôt invitent- ils la personne et lui témoignent-ils tant d’amour qu’ils lui donneraient leur cœur.»
Il insiste sur leur caractère pacifique : « Ils ne portent pas d’armes ni même ne
les connaissent, car je leur ai montré des épées que, par ignorance, ils prenaient par
le tranchant, se coupant.» Une découverte qui va le décider à les «coloniser» au nom des suzerains espagnols.
Au fond, vous défendez la théorie du “bon sauvage” de Jean-Jacques Rousseau ?
En effet, toutes mes recherches m’ont poussé du côté de Jean-Jacques Rousseau et de sa conception d’une nature humaine fondamentalement bonne mais pervertie par des civilisations violentes et tyranniques. C’est lui qui écrit dans le préambule du Contrat social (1762) :
« L’homme est né libre et partout il est dans les fers. » Qui s’écrie dans son Discours sur les origines et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) : «Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne. » Rousseau a longtemps été considéré comme un naïf et sa théorie du « bon sauvage » a été très critiquée, on lui a opposé le «réalisme» de Thomas Hobbes, le philosophe britannique qui publia en 1651 Léviathan, le premier traité de politique moderne.
Pour Hobbes, l’homme originel est fondamentalement mauvais, cruel, égoïste, sa liberté le mène à tuer ses rivaux et s’emparer de ses biens, « la guerre de tous contre tous » règne, cela dès les débuts de l’humanité. Pour y mettre fin, il faut, assure Hobbes, un État et un souverain forts, disposant de forces de police, et que l’individu comme le peuple abdiquent leur liberté au profit de la sécurité et de la paix sociale. Il est intéressant de confronter les théories de Hobbes et de Rousseau aux dernières recherches en histoire et en anthropologie. Si Hobbes a raison, alors les premiers hommes auraient dû accueillir avec joie les premiers États forts, c’est-à-dire les premiers chefs de tribu, les premiers rois. Or rien n’est plus éloigné de la vérité historique à en croire les études de James Scott, Homo Domesticus (La Découverte, 2019) ou de l’anthropologue Pierre Clastres, La Société contre l’État (Éditions de Minuit, 1974).
« Il est intéressant de confronter Hobbes et Rousseau aux dernières recherches en anthropologie.»
Dans les faits, les peuples de chasseurs-cueilleurs fuyaient les premiers gouvernements despotiques, que ce soit dans l’Égypte pharaonique, ou encore en Mésopotamie et en Grèce, et cela pour plusieurs raisons. C’étaient des régimes tyranniques et esclavagistes,
ils collectaient des impôts qui écrasaient le peuple, ils enrôlaient de force les hommes jeunes dans leurs armées, ils possédaient les terres et transformaient les paysans en serfs. Cela donne raison à Rousseau, qui dénonçait la sédentarisation forcée, la prise du pouvoir politique et foncier par des seigneuries et des royautés despotiques, les guerres de conquête, l’urbanisation insalubre…
Parlez-nous de la “théorie du vernis civilisé” qui craque dès que les humains traversent une crise grave.
C’est le biologiste Frans de Waal, spécialiste des comportements empathiques dans le monde animal, qui a défini ce qu’on appelle la « théorie du vernis ». Selon celle-ci, la civilité ne serait qu’une mince couche brillante mais fragile. Elle craque à la première situation difficile, suite à quoi l’humain révèle alors sa vraie nature, violente et égocentrique. Cette conception a ses grands défenseurs depuis Machiavel, qui écrivait « Souvenez-vous que tous les hommes seraient des tyrans s’ils le pouvaient », jusqu’à Freud qui assurait que « nous sommes les descendants
d’une immense chaine de génération de meurtriers. Nous avons le meurtre dans le sang ». Un des ouvrages les plus fameux mettant en scène la théorie du vernis est sans doute Sa Majesté des mouches(Gallimard, 1956) du britannique William Golding. Ce roman a été vendu à des dizaines de millions d’exemplaires, adapté au cinéma, et raconte l’histoire tragique de quinze écoliers de la haute société anglaise qui se retrouvent sur une ile déserte suite à un accident d’avion. Rapidement, leur bonne éducation se fendille, ils forment une tribu violente qui honore un dieu à tête d’animal, organise des chasses à l’homme, opprime les faibles. William Golding écrit : « L’homme produit le mal comme l’abeille produit le miel. »
Rappelons que Sa Majesté des Mouches est une fiction. Dérangeante, frappante, mais une fiction. Il n’y a pas l’ombre d’une preuve que des enfants abandonnés à eux-mêmes agiraient ainsi. Cela m’a motivé pour enquêter, j’ai fini par découvrir une histoire similaire, celle de six jeunes Polynésiens qui se sont échoués en 1966 sur la petite ile déserte de ‘Ata, dans l’archipel desTonga. Ils y sont restés quinze mois. Il n’y a eu aucun mort. Pas de panique. Ils ont survécu grâce à leur solidarité, ils ont cultivé un potager, élevé des poules, installé un terrain de football et entretenu un feu permanent pour prévenir d’éventuels sauveteurs. Cette histoire raconte une tout autre histoire d’amitié et de loyauté. La belle réalité dépasse la triste fiction…
Une autre belle histoire est celle des soldats qui ne tirent pas…
Après la Seconde Guerre mondiale, des historiens américains entreprirent d’interroger des vétérans, et ils découvrirent que plus de la moitié d’entre eux n’avaient jamais tué personne, et que la plupart des victimes étaient dues à une petite minorité. Ainsi, le colonel et historien Samuel Marshall questionna les soldats qui avaient débarqué en novembre 1943 dans l’ile deMakin, dans l’océan Paci que, pourdéloger les Japonais. Quoique supérieurs en nombre, ils campèrent sur leurs positions, sans faire reculer l’ennemi. Marshall se rendit compte que la plupart des soldats occupaient leurs bastions, mais sans tirer. Troublé, il mena plusieurs entretiens auprès d’autres soldats, et s’aperçut que seulement 15 % à 20 % d’entre eux tiraient – que l’immense majorité s’y refusait. Ce n’est pas qu’ils avaient peur, ou quittaient leur poste : non, ils répugnaient à tuer.
Marshall consigna ses enquêtes dans son ouvrage Men Against Fire, paru en 1947 [non traduit], présent dans toutes les académies militaires, où il écrit :
«L’homme ordinaire et sain d’esprit manifeste une telle résistance intérieure et généralement inconsciente à la perspective de tuer un de ses semblables qu’il ne lui ôtera pas la vie de son propre chef. »D’après lui, le refus de l’agression fait partie intégrante de la « constitution émotionnelle » des hommes. Il pensait très sérieusement que ses analyses concernaient tous les soldats, de toutes les guerres, de tous les temps.
Marshall a été critiqué par la suite…
C’est vrai, des historiens ont estimé qu’il avait surinterprété les témoignagesdes soldats pacifiques et tordu le cou à laréalité. Cependant, peu à peu, d’autres recherches historiques et en psychologie militaire ont réévalué ses découvertes, comme celles du britannique Richard Holmes, du lieutenant-colonel américain Dave Grossman ou du canadien
Elles montrent par exemple que moins de 1 % des pilotes de chasse américains ont été responsables de 40 % des avions ennemis abattus pendant la guerre de 1939-1945 – la plupart des pilotes « n’avaient jamais abattu quelqu’un, ni même essayé » écrit Richard A. Gabriel. Que dans les années 1860, à lire les questionnaires distribués dans l’armée française par le colonel Ardant du Picq, les armées européennes se tiraient dessus pendant des heures sans faire beaucoup de blessés.
Pourquoi ? Les soldats visaient exprès trop haut, nombre d’entre eux s’affairaient à autre chose qu’à tirer : construire un abri, aller chercher des munitions, etc. Le lieutenant-colonel Dave Grossman fait ce commentaire :« La conclusion la plus évidente de tout cela, c’est que la plupart des soldats n’essayaient pas de tuer l’ennemi. »
Toutes ces recherches contredisent la théorie de l’homme violent par nature, prédisposé au meurtre. En réalité, pour qu’un humain, soldat ou non, soit capable de tuer, il doit être conditionné à le faire. Il faut briser son empathie et sa pitié naturelles, déshumaniser l’ennemi, lui faire subir un lavage de cerveau, ou encore le droguer, le rendre psychotique. Qui plus est, quand les soldats reviennent de combats violents, où ils ont tué, ils sont gravement traumatisés, parfois en état de démence. Tout cela veut bien dire quelque chose : nous ne sommes pas faits pour la guerre et la violence ; nous sommes des créatures empathiques et conviviales, qui cherchons à vivre en paix, avec tout le monde… Mon optimisme est un réalisme.