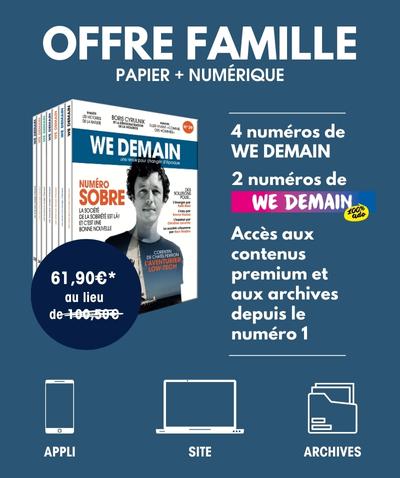Partager la publication "David Christian : “La Terre est en train de devenir consciente d’elle-même”"
Il y a des livres qui changent la façon dont on regarde le monde. Origines, une grande histoire du monde, du Big Bang à nos jours de David Christian, traduit en français aux éditions Arpa, en fait indéniablement partie. L’historien australien y déploie un récit vertigineux mais limpide : celui de l’univers, de la matière, de la vie, et enfin de nous, humains. Le tout en moins de 400 pages. Un condensé d’intelligence, de rigueur scientifique et de pédagogie, qui propose de reconnecter les savoirs éparpillés dans les silos disciplinaires (astronomie, physique, biologie, histoire…) pour dessiner une fresque cohérente de notre place dans le cosmos. Une mise en perspective dont l’humanité a bien besoin à l’aune des événements actuels, qu’ils soient environnementaux comme géopolitiques.
Cette approche, qu’il nomme la “Big History”, réenchante notre regard sans renier les faits. Elle redonne du souffle à la pensée critique et ouvre des voies pour imaginer collectivement un avenir plus conscient. Alors que l’Anthropocène impose une nouvelle responsabilité à notre espèce, David Christian invite à faire de l’histoire un outil d’émancipation et de lucidité. En structurant son récit autour de seuils clés, il met en lumière les moments où la complexité a émergé dans un cosmos gouverné par l’entropie. C’est la tendance naturelle d’un système à aller vers le désordre, comme une tasse qui se brise mais ne se reconstitue jamais seule. Jusqu’où le monde pourra-t-il se complexifier ? Entretien avec un homme qui rêve d’un monde où l’éducation s’élargit à l’échelle de l’humanité tout entière.

Comment résumer l’ensemble du savoir humain en moins de 400 de pages ?
C’est un pari fou, je vous l’accorde. Mais il ne s’agit pas de tout dire. Il s’agit de trouver un fil rouge. Très tôt, j’ai compris que ce que je faisais en classe — expliquer l’histoire du monde de manière globale à des étudiants — pouvait prendre la forme d’un récit. Or, toutes les cultures humaines racontent des récits d’origine. Même la nôtre, qui prétend parfois ne pas en avoir. En réalité, on en a besoin. Nous sommes saturés d’informations, mais privés d’un cadre global pour les organiser. Mon projet, c’est d’offrir ce cadre-là, en m’appuyant sur les connaissances scientifiques, plutôt que sur les dogmes.
Et ce cadre passe par une idée centrale : la complexité. Pourquoi ?
Parce que c’est ce qui saute aux yeux quand on observe le monde avec un peu de recul. L’univers a commencé de manière extraordinairement simple. Il n’y avait même pas d’atomes, juste de l’énergie et des particules élémentaires. Et pourtant, 13,8 milliards d’années plus tard, il y a des humains qui construisent des télescopes, composent des symphonies et réfléchissent à leur place dans le cosmos. C’est sidérant.
Mais cela va à l’encontre d’un principe fondamental : l’entropie. L’entropie, c’est la tendance naturelle d’un système à aller vers le désordre. C’est l’un des grands principes de la thermodynamique : dans un système fermé, l’énergie se disperse, le désordre augmente, et l’ordre devient de plus en plus difficile à maintenir. Alors comment la complexité a-t-elle pu apparaître ? C’est cette contradiction apparente qui m’a fasciné. Et c’est autour de cette tension que j’ai structuré mon récit.
Vous parlez de “seuils” de complexité. Pouvez-vous nous expliquer ce concept et comment vous les avez choisis ?
Ce ne sont pas des vérités gravées dans le marbre. Ce sont des outils. Des repères pédagogiques. Quand j’ai commencé à enseigner ce cours, dans les années 1990, je faisais intervenir des astronomes, des biologistes, des géologues… Et mes étudiants, comme moi, étaient perdus. Tout semblait déconnecté. J’ai mis des années à comprendre qu’il y avait une histoire commune. Un récit qui va du simple au complexe, en passant par des seuils : l’apparition des étoiles, des planètes, de la vie, des espèces conscientes… Ces seuils ne sont pas les seuls possibles, ils peuvent être débattus car ce sont des choix personnels. Mais ils m’ont permis de structurer cette montée en complexité.
Et vous avez intégré l’Anthropocène parmi ces seuils alors que, à l’aune de l’histoire du monde, nous ne sommes qu’un infime battement de cils dans l’immensité du temps…
Oui, mais c’est précisément ce qui en fait un moment clé. L’univers existe depuis près de 14 milliards d’années, et la Terre depuis plus de 4 milliards. Pourtant, en quelques millénaires à peine, l’espèce humaine a modifié les grands équilibres planétaires. Ce n’est pas rien. C’est une rupture. Et il faut l’assumer pleinement. Etpuis, soyons honnêtes, ce qui nous intéresse le plus, ce n’est pas l’univers dans son ensemble, c’est notre place dans cet univers.
C’est pourquoi l’Anthropocène, même s’il ne concerne qu’une toute petite portion du temps cosmique, est central. C’est le moment où une espèce devient capable de modifier les conditions de vie de toute une planète. Une espèce qui agit en conscience, qui crée, qui détruit, mais aussi qui peut choisir. Pour moi, c’est à la fois une énigme, une responsabilité et une occasion. C’est l’un des rares seuils où le futur dépend, au moins en partie, de décisions conscientes prises collectivement. Et cela, dans l’histoire de l’univers, c’est absolument inédit.
Vous évoquez un “neuvième seuil”. Qu’est-ce que ce serait ?
C’est encore une hypothèse, bien sûr, mais de plus en plus, je pense qu’un nouveau seuil est en train d’émerger. Quelque chose d’inédit dans l’histoire de la Terre : une forme de conscience collective. Pour la première fois, certaines décisions prises en conscience par une seule espèce — la nôtre — influencent le devenir de toute une planète. C’est vertigineux. On peut formuler cela ainsi : la Terre est en train de devenir consciente d’elle-même. Et je ne dis pas cela de manière mystique. C’est, au fond, une description assez précise de ce qui se passe.
Car cette conscience, elle se manifeste de manière très concrète. La fabrication de la bombe atomique en est l’exemple le plus dramatique. C’est une décision humaine qui a changé les règles du jeu à l’échelle planétaire. Mais nous sommes aussi capables du meilleur : de concevoir des vaccins, de coopérer à l’échelle mondiale comme peut le faire Médecins sans Frontières par exemple, d’inventer des institutions comme l’ONU ou les Accords de Paris. Je crois profondément que cette capacité à collaborer est ce qui nous définit — et ce qui nous sauvera.
Donc je suis, malgré tout, plutôt optimiste. Si l’on prend un peu de recul sur l’histoire humaine, on voit une espèce qui a toujours su apprendre, s’adapter, et coopérer dans des conditions nouvelles. Et aujourd’hui, j’observe, sous la surface des conflits, des signes de coordination mondiale inédits. C’est cela que j’appelle le neuvième seuil : l’émergence d’un super-organisme planétaire, fait d’humains et de technologies, capable — peut-être — d’agir avec lucidité sur son propre avenir.
L’intelligence artificielle peut-elle jouer un rôle dans cette conscience planétaire et cet apprentissage collectif permanent ?
L’IA en fait déjà partie. C’est une extension de nos capacités cognitives. Comme un outil, au même titre qu’un microscope ou une calculatrice. L’intelligence artificielle peut accélérer la circulation du savoir, aider à résoudre des problèmes complexes. Mais, selon moi, elle ne remplacera pas l’humain. Ce qui nous rend uniques, c’est la capacité de partager, d’accumuler et de transmettre le savoir — ce que j’appelle l’apprentissage collectif. Les chimpanzés sont brillants, mais ils ne peuvent pas construire des civilisations. Nous, si. Grâce à notre capacité à apprendre les uns des autres.
L’intelligence artificielle s’inscrit bien sûr dans cette montée en complexité, mais je reste très sceptique sur l’idée qu’elle puisse un jour devenir consciente. Pour moi, ce n’est pas une entité pensante, c’est un outil, puissant certes, mais fondamentalement dépourvu de subjectivité. Elle peut battre n’importe quel humain aux échecs, compiler des milliards de données, formuler des prédictions… mais elle ne sait pas qu’elle existe. Elle ne ressent rien.
La conscience humaine, elle, s’enracine dans des millions d’années d’évolution biologique, de langage, d’émotions, de culture. L’IA, même la plus avancée, reste à l’extérieur de cette trajectoire. Elle peut nous aider à penser, mais elle ne pense pas par elle-même. Et je crois qu’on n’atteindra jamais ce seuil de conscience artificielle. C’est pourquoi il est si important de ne pas lui déléguer nos responsabilités : la conscience, la vraie, reste l’affaire des humains.
Votre livre a-t-il aussi une ambition écologique ?
Oui, profondément. Même si ce n’était pas son intention première, je crois que Origines peut nourrir une forme de conscience écologique — au sens large, au sens étymologique presque : une conscience de la maison commune. Il s’inscrit dans une tradition qui va de James Lovelock et sa théorie Gaïa jusqu’aux penseurs de la “noosphère”, cette idée que la planète entre dans une phase d’autoréflexion, rendue possible par l’émergence d’une espèce capable de comprendre, et peut-être de maîtriser, ses propres impacts.
Cette perspective change tout. Elle nous sort d’une vision morcelée, centrée sur les frontières nationales, pour replacer l’humanité dans le cadre plus vaste des systèmes terrestres. Et je suis convaincu que l’enseignement de la Big History peut aider à cette prise de conscience. En apprenant aux jeunes à penser à l’échelle de l’espèce, de la planète, voire de l’univers, on leur donne des outils pour comprendre les défis systémiques d’aujourd’hui : changement climatique, effondrement de la biodiversité, déséquilibres énergétiques. Ce n’est pas une leçon de morale, c’est une invitation à regarder le monde autrement. À reconnecter savoirs et responsabilités.
Mais comment garder espoir face aux crises ?
C’est une vraie question. Et j’y réfléchis beaucoup. Il y a un biais très fort dans les récits qu’on nous propose : ce que j’appelle le “biais du sang”. Les mauvaises nouvelles frappent plus fort. Les médias — et pas seulement eux, les réseaux sociaux aussi — nous montrent surtout le pire. C’est en partie biologique : notre cerveau est câblé pour réagir plus fortement aux menaces qu’aux bonnes nouvelles. C’est un héritage de notre évolution — repérer le danger a toujours été une question de survie. Mais ce réflexe, utile dans la savane, devient un piège dans le monde contemporain. Il alimente une perception du monde exagérément sombre, où le chaos semble l’emporter sur tout le reste. Nous sommes trop pessimistes d’une manière générale.
Alors que si on prend un peu de recul, il y a aussi des signes encourageants. Le fait que tous les pays aient signé les Accords de Paris, par exemple, qu’on soit parvenu à créer l’ONU… Ou les progrès spectaculaires dans les énergies renouvelables. Bien sûr, tout cela est fragile. Mais ce n’est pas rien.
Depuis la publication de votre livre, votre vision du futur a-t-elle évolué ?
Oui, je pense que je suis devenu un peu plus prudent… et paradoxalement, plus optimiste. Le futur est ouvert. Il n’est pas écrit. Il peut basculer du bon ou du mauvais côté. Mais je vois des signes que nous apprenons, collectivement. Que nous devenons capables de penser à long terme. Et cela me donne de l’espoir. Je crois aussi que notre espèce va continuer d’évoluer — biologiquement même. On pourra sans doute modifier notre ADN, prolonger nos vies, nous implanter sur d’autres planètes. Tout cela pose des questions éthiques vertigineuses. Mais c’est déjà en cours.
Et puis, il y a cette autre question qui revient souvent : sommes-nous seuls dans l’univers ? Les scientifiques ont tendance à penser, et moi aussi, que la vie, sous des formes variées, est probablement répandue ailleurs. Ce serait presque statistiquement improbable que la Terre soit la seule oasis de complexité biologique dans un cosmos aussi vaste. En revanche, une planète où cette vie aurait conduit à une conscience capable d’agir collectivement — comme la nôtre commence peut-être à le faire — c’est autre chose. Si nous découvrons un jour d’autres “planètes conscientes”, cela bouleversera notre rapport au monde. Et si nous ne les trouvons pas… cela donne encore plus de poids à ce que nous sommes en train de vivre ici.
S’il ne fallait retenir qu’une idée de votre livre, laquelle serait-ce ?
Que la connaissance humaine peut être unifiée. Qu’on peut, malgré la complexité du monde, tracer un récit cohérent, accessible, et riche de sens. Et surtout, que ce récit peut nous aider à nous reconnaître comme membres d’une communauté humaine globale. À dépasser les frontières, les clivages, les replis. Enseigner l’histoire de l’humanité comme un tout, ce n’est pas nier les identités, c’est les inscrire dans un horizon plus vaste. Et c’est exactement ce dont nous avons besoin aujourd’hui.
Origines – Une grande histoire du monde du Big Bang à nos jours, David Christian, Éditions Arpa, mars 2025, 400 pages, 22,90€.
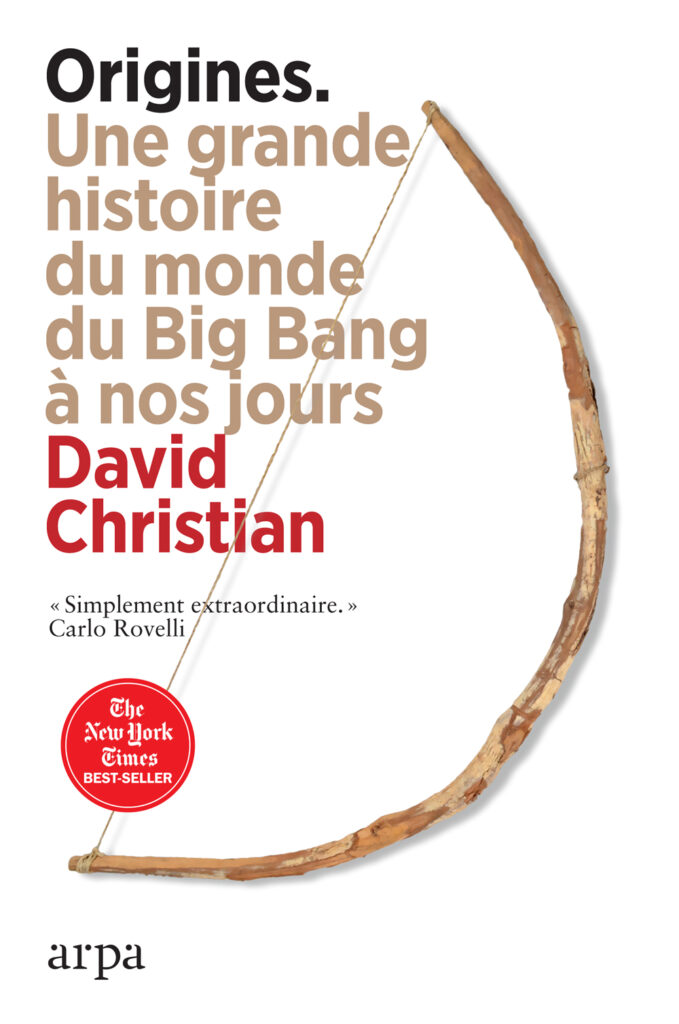
SOUTENEZ WE DEMAIN, SOUTENEZ UNE RÉDACTION INDÉPENDANTE
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire
et abonnez-vous à notre magazine.