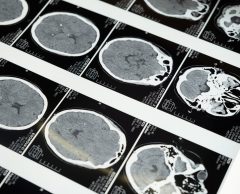Partager la publication "Il marche 33 800 kilomètres dans les pas de l’humanité"
Par un jour de janvier 2013, lassé de son métier de grand reporter qui lui fait voir le monde en accéléré, Paul Salopek décide de partir pour une longue, très longue marche sur les traces de nos ancêtres. Nom du projet : Out of Eden Walk, une marche pour sortir du jardin d’Eden. Son fol objectif ? Parcourir 33 800 kilomètres depuis le site de Herto en Éthiopie, berceau de l’espèce humaine, jusqu’à la Terre de feu, au sud du Chili, où il espérait retrouver Cristina Calderón, dernière locutrice native du yagan, alors âgée de 84 ans. Au fil de son périple, celui qui se revendique du slow journalism (le journalisme qui prend son temps) voulait raconter le monde à hauteur d’homme. L’entreprise devait durer sept ans, c’était il y a huit ans.
J’ai écrit à Paul Salopek en février, alors qu’il était à Rangoun, en Birmanie, à 11 600 kilomètres de son point de départ. Un léger retard qui n’inquiète pas le moins du monde l’infatigable marcheur de 59 ans.
Cet article a initialement été publié dans WE DEMAIN n°34, paru en mai 2021. Un numéro toujours disponible sur notre boutique en ligne.
La marche pour parcourir le monde
Le site du National Geographic consacré au projet Out of Eden Walk affiche cette devise : “Slow down, find humanity” (“ralentir, trouver l’humain”). Quelques mots qui résument à la perfection cette équipée dantesque. Si Paul Salopek a décidé de parcourir le monde à pied, c’est pour renouer avec ses habitants. Avant 2013, sa pratique du journalisme consistait à sauter d’un avion à l’autre; d’une zone de guerre à une catastrophe naturelle. Le grand reporter américain a couvert les guerres d’Afghanistan et d’Irak, écrit sur le Mexique, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Sénégal ou le Mali pour le Chicago Tribune et le National Geographic.
Un rêve pour pas mal de journalistes… Mais qui laissait un arrière-goût d’amertume à ce double prix Pulitzer frustré de traiter ces événements comme des sujets séparés alors que, dans le monde réel, tout est interconnecté. Un conflit au Darfour (où Paul Salopek y a été retenu en otage en 2006) est le fruit de précédentes tensions dans la région. Un glissement de terrain peut être causé par le dérèglement climatique, lui-même aggravé par la déforestation.
Arpenter la Terre pas à pas, ralentir donc, permettrait au journaliste de rassembler les pièces du puzzle, de raconter une histoire plus complexe. Et de retrouver un peu d’humanité. Car la marche impose de prendre le temps. Paul Salopek ne rencontre plus des sujets ou des témoins, mais des compagnons de route dont il partage le mode de vie. Mais l’humain, c’est aussi en lui que le journaliste l’a retrouvé.
“Ce besoin vital d’être aimé”
“J’aime penser que ralentir est un cadeau à plusieurs niveaux, avec plusieurs significations. Quand on entreprend une longue marche, peu importe où, on crée souvent des relations plus profondes avec les autres. Mais on crée aussi les conditions pour se trouver soi-même, pour trouver sa propre humanité. Même après avoir vu le pire dont l’être humain est capable – et j’ai été témoin d’infamies qui m’ont vraiment donné envie de vomir –, je suis plus souvent stupéfié par la bonté dont on peut faire preuve spontanément. Par notre courage inexplicable. Par notre générosité folle. Et par ce besoin profond et récurrent, vital, d’être aimé.
C’est vraiment déconcertant. Pas besoin de traverser l’Ouzbékistan à pied pour comprendre ce genre de choses; qui sont, somme toute, des observations plutôt banales. Mais l’expérience intérieure et extérieure du déplacement à pied à travers des paysages habités augmente les chances de faire ces rencontres et de les assimiler proprement. Ce que j’entends par là, c’est que ces affirmations deviennent récurrentes. Savez-vous quels bruits font vos pas quand vous marchez autour du monde ? Yes, Yes, Yes, Yes.”
Mais Salopek ne se contente pas de marcher et d’acquiescer : il documente son voyage, interroge tout ce qu’il voit. À travers de longs articles parus dans le National Geographic, qui soutient le projet depuis ses débuts, ou plus rarement dans le New Yorker. Il raconte la vie sur les anciennes routes de la Soie ou le quotidien d’orfèvres birmans. À travers, aussi, des cartes détaillées, élaborées avec l’aide du Centre d’analyse géographique de Harvard, qui mettent en avant certains aspects inattendus de son voyage.
À lire aussi : Il a fait Paris-Hong Kong à vélo : ses conseils pour partir en cyclo-rando
Des détours inattendus
L’une d’elles repère l’ensemble des contrôles de police auxquels il a été soumis, un tous les cent soixante kilomètres en moyenne, avec d’énormes disparités : si “l’Inde rurale a été un rêve piétonnier”, le journaliste a été contrôlé 28 fois lors de sa traversée de l’Ouzbékistan, entre le 11 juin et le 4 novembre 2016… Soit un arrêt tous les cinq jours ou presque.
Une autre carte met en lumière les kinks, ces nœuds ou détours inattendus, enregistrés par son GPS. Si, vu d’en haut, l’itinéraire semble plutôt fluide, il ne l’est pas en visualisant les multiples circonvolutions inhérentes à la marche. Dans la vallée du Grand Rift, en Éthiopie, Paul Salopek et ses guides se perdent dans les 50 000 hectares de désert convertis en champs de canne à sucre irrigués de canaux tracés au cordeau ; près de Nazareth, en Israël, le tracé GPS ressemble plus à un gribouillis qu’à un détour : Paul Salopek et ses amis font les cent pas, anxieux, tandis qu’un garde armé inspecte leurs papiers ; en Turquie, la superposition des traces indique que le journaliste a fait demi-tour après avoir compris qu’il avait oublié son appareil photo.
La fin du voyage
À quoi ressemble le quotidien d’un marcheur au long cours ? Comment organise-t-on un tel périple en amont, puis une fois en route ? “Je fais parfois appel à National Geographic pour décrocher des visas difficiles à obtenir. Pour le reste, ça se fait à l’instinct, à l’expérience. Je me promène, je n’ai pas entrepris une expédition.” Est-ce que son foyer lui manque ? “Ce sont les gens qui me manquent. Mais je ne serais pas contre une tasse de thé au gingembre.” Pense-t-il à la fin de son voyage ? “Pas vraiment. Je ne pense pas à la fin de cette marche en termes géographiques. Je ne sais pas ce que je trouverai.”
Des réponses presque cryptiques qui tranchent avec les longs récits dont il abreuve les lecteurs depuis presque dix ans. Qui de la mauvaise connexion Internet ou de la marche sans fin incite à économiser ses mots ? La seconde sans doute, même si, à propos de son travail, il affirme : “On pourrait croire que réfléchir à son texte pendant vingt-cinq kilomètres va le rendre meilleur… En tout cas, ça n’est pas plus facile qu’avant.” En ralentissant, le journaliste montre que notre monde bouge à toute vitesse. Le berceau de Sapiens qu’il a quitté en 2013 a cédé son titre au site de Djebel Irhoud, au Maroc, où des fossiles de 315 000 ans environ ont repoussé de 100 000 ans la date de naissance de notre espèce. Normal : “La science est vivante, elle se modifie, mûrit en permanence. Si elle ne changeait pas, il s’agirait d’un dogme.”
33 800 kilomètres de marche : des chocs et la lenteur
En huit ans, le dérèglement climatique s’est imposé dans les débats politiques, le capitalisme est plus que jamais remis en cause, la confiance dans les démocraties s’érode, les révoltes sociales se multiplient dans les pays industrialisés, tout comme les attentats… Des chocs qui contrastent avec la lenteur de la marche mais dont Paul Salopek fait l’expérience chaque jour.
“Il est impossible de rater ces convulsions quand leur ampleur est mondiale. Je les ai traversées. Les crises climatiques font partie de ma vie. Le Covid est présent dans le village où je me suis arrêté l’an dernier pour attendre que la pandémie passe. Quant aux mouvements sociaux et à l’érosion de la démocratie, pas besoin d’être en France ou aux États-Unis pour en être témoin. Je les vois partout où je me rends. C’est juste qu’ils ne font pas l’objet d’autant d’attention, parce que les centres de pouvoir dominent le discours médiatique.”
Marcher, c’est se reconnecter au monde : à son environnement immédiat comme aux convulsions qui agitent nos sociétés interconnectées, globalisées. Une excellente raison de s’y mettre. Car, après tout, “le nomadisme a été le mode de vie de notre espèce pendant 95 % de son existence. Ces vieux rythmes iambiques vibrent encore dans notre psyché, dans nos façons de marcher et notre ADN. On se sent bien quand on se déplace à pied. Pas besoin d’abandonner possessions et relations, et de traverser la France. Pour retrouver la nature primordiale du chez-soi des marcheurs d’antan, un horizon qui se déplace lentement, on peut planter des tomates comme Candide et se contenter de sa balade quotidienne jusqu’au café : des micromigrations. On n’a jamais vraiment arrêté de bouger.”
À lire aussi : Tourisme et voyage aux temps post-humains